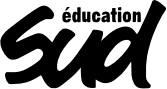Par Christopher Pereira
Les critiques réalisées à l’encontre de l’école dans sa globalité ne sont pas une nouveauté. Célestin Freinet la qualifiait en son temps de « fille et servante du capitalisme ». Plus récemment, au printemps 2017, le MEDEF lançait une campagne avec ces propos : « Si l’école faisait son travail, j’aurais du travail… ». De fait, elle s’insère dans le système idéologique de la société où elle est développée en se mettant à son service. Ainsi, dans le monde capitaliste actuel, l’institution scolaire sert avant tout à classer, sélectionner, discriminer.
Le constat général sur le service public d’éducation nationale est assez clair. Celui-ci dysfonctionne et se trouve constamment dégradé par les gouvernements successifs. La logique a été de détruire les services publics en appliquant la méthode mise en évidence par Noam Chomsky : commencer par baisser son financement afin qu’il ne fonctionne plus, provoquer l’insatisfaction de la population qui voudra alors autre chose, privatiser enfin ce service public. Cependant, si les critiques fusent de toutes parts, elles n’ont pas les mêmes origines idéologiques, ne portent pas sur les mêmes causes et n’ont pas les mêmes conséquences.
À droite, les critiques évoquent de façon péjorative le « pédagogisme » des enseignant·e·s en revendiquant un retour vers une école conservatrice. C’est une critique qui fonde son discours sur une vision erronée d’une école qui n’a jamais existé et d’un passé mythifié. Elle milite pour l’instauration de l’uniforme, le retour des classes de niveau ou encore la fin du collège unique. Son poids politique est conséquent : défense de l’enseignement privé, imposition de la réforme dite du « Choc des Savoirs ». À gauche, on évoque plus généralement une école sclérosée qui ne prend pas en compte l’enfant comme individu. La pédagogie est également critiquée, qualifiée de désuète et inadaptée. On dénonce enfin l’absence générale de moyens, qui permettraient justement d’innover pédagogiquement et de réduire le nombre d’élèves par classe, ainsi que le financement du privé par l’argent public. Le risque est alors de voir se développer des enseignements alternatifs dans des écoles privées hors contrat.
Face à ces constats de dysfonctionnement fleurissent les pédagogies dites « alternatives », avec un engouement particulier pour Montessori ou l’ouvrage de Céline Alvarez, « Les Lois naturelles de l’enfant ». La droite et l’extrême droite diffusent de cette façon, dans les établissements privés mais aussi dans l’enseignement public, une rhétorique qui pourrait s’approcher des courants pédagogiques émancipateurs. Or, ce qui est proposé ne remet pas fondamentalement en cause le fonctionnement de l’institution scolaire. Au contraire, les projets sont développés au service d’une idéologie néolibérale, conservatrice et raciste. Pour combattre ce phénomène, il est nécessaire de débusquer les éléments de langages mobilisés, d’identifier les financements apportés et de dénoncer les liens existants avec le pouvoir et le grand capital. Il s’agit dès lors de démontrer comment la droite et l’extrême droite instrumentalisent les pédagogies « alternatives » pour défendre leurs intérêts de classe.
1.Les intérêts particuliers du patronat pour la question scolaire
Pour le patronat, l’objectif de l’école est simple et concret : répondre aux besoins du marché du travail et des entreprises. La question de l’émancipation de l’humain n’entre pas dans l’équation. Il s’agit uniquement de former une main-d’œuvre servile et peu chère. L’école doit donc être au service du capital. Dès lors, et ce n’est pas nouveau, elle devient une source d’intérêt :
« Parce que le niveau global d’éducation et le niveau culturel d’un pays ont un impact déterminant sur l’environnement dans lequel se développe l’activité entrepreneuriale, l’entreprise est fondée à porter un avis sur la manière dont ce pays investit ou non dans son système éducatif, et plus encore à agir, car partout elle est considérée comme un partenaire naturel de l’école1. »
Cette idéologie est soutenue et développée par des investissements financiers et un lobbying constant, notamment grâce à l’action de l’Institut Montaigne fondé en 2000 par l’entrepreneur Claude Bébéar.
Concrètement, les dispositifs et les partenariats du MEDEF avec l’Éducation nationale se développent à un tel point qu’il devient complexe d’en faire une liste exhaustive : Semaine École/Entreprise, Parcours Avenir, Label Lycée des Métiers, Action École Entreprise, Salon des mini-entreprises, Campus des métiers et des qualifications, Pôle Stage, IDE (Institut du monde de l’entreprise qui intervient sur les programmes de SES), CNEE (Conseil national d’éducation économique), Semaine de l’Industrie… Tous ces dispositifs lient l’école au monde de l’entreprise et témoignent de l’entrisme du MEDEF dans l’institution scolaire.
La stratégie des classes dominantes n’est plus de s’en tenir au secteur de l’enseignement privé. Elles disposent déjà de leurs écoles d’élites, à l’instar des collège et lycée Stanislas à Paris, où se cultive l’entre-soi des privilégiés et la culture du réseau. Ces établissements se concentrent sur la formation des cadres et des dirigeant·e·s, et non de la main-d’œuvre. Pour cette dernière, il y a l’école publique. La vision développée est ainsi extrêmement ségrégative et correspond aux dernières réformes du gouvernement Attal – lui-même passé par l’École Alsacienne – comme celle du « Choc des Savoirs » et ses groupes de niveau. L’objectif est, pour la droite et l’extrême droite, de revenir sur l’existence du « collège unique ». L’enjeu de l’école publique est donc réel.
Cette stratégie met en place des outils à son service, notamment avec la création en 2010 de l’association Agir pour l’école (APE) par le même Claude Bébéar. Le lien avec l’Institut Montaigne, est donc sans équivoque, tout comme avec le monde politique. En effet, sa création a été soutenue par Jean-Michel Blanquer, alors directeur général de l’Enseignement scolaire, par ailleurs membre de son comité directeur jusqu’à sa nomination en tant que ministre de l’Éducation nationale en 2017. Derrière cette initiative, ce sont bien des grandes entreprises que proviennent la majorité des financements : Groupe AXA, Total, Groupe Dassault.
Cet entrisme du privé dans le public se manifeste ainsi concrètement par plusieurs millions de dons qui sont eux-mêmes défiscalisés à 66 %, voire 75 % si l’action cible les publics en difficulté comme les élèves de REP et REP+, à l’image de l’association Énergie Jeune. L’enjeu est de taille pour celles et ceux qui défendent l’enseignement public. Défiscaliser, sous couvert de philanthropie, revient à détourner de l’argent public – qui ne rentre pas dans les caisses de l’État – pour servir les intérêts du privé. Il s’agit peu à peu, pour ces « associations », de se substituer aux missions de l’État en « dénationalisant » l’action publique d’éducation pour l’ouvrir aux enjeux économiques de l’entreprise privée.
Pour cela, la communication de ces acteurs privés se base notamment sur « l’expérimentation et l’innovation », en mettant en avant une extrême rigueur scientifique. Cette rhétorique, qu’on peut qualifier de scientisme pédagogique, est une constante dans les instituts d’influence libéraux. L’idée est que les pratiques éducatives et les méthodes d’enseignement devraient être fondées sur des résultats scientifiques solides. Cela conduit à privilégier l’utilisation des recherches en sciences cognitives pour les appliquer aux méthodes d’enseignements efficaces. Cette approche connaît deux limites :
- le risque de réduire la complexité éducative à des indicateurs mesurables, au détriment de dimensions humaines, culturelles ou sociales ;
- une trop grande dépendance aux « données probantes » qui peut ignorer le rôle de l’expérience pratique des enseignants.
Ce scientisme pédagogique s’accompagne souvent d’un solutionnisme technologique appliqué à l’éducation. Cela sous-entend que la technologie (outils numériques, plateformes d’apprentissages, IA…) peut résoudre les problèmes de l’éducation ou transformer radicalement l’enseignement. Cela se traduit notamment par l’introduction massive de tablettes ou d’ordinateurs en classe, ou l’utilisation de plateformes d’apprentissage en ligne personnalisées, avec la conviction que cela améliorera automatiquement les apprentissages. C’est notamment ce qu’on observe chez AEP qui développe son action autour d’applications à utiliser sur des tablettes. On retrouve ainsi des élèves seuls, isolés, assis devant un écran avec un casque sur les oreilles. Les limites à ce solutionnisme technologique sont nombreuses :
- une dépendance excessive aux outils technologiques peut accentuer les inégalités (par exemple dans les zones défavorisées où l’accès au numérique est limité) ;
- la technologie ne remplace pas la relation humaine entre enseignant et élève, qui reste essentielle à l’apprentissage ;
- le « mythe » de la technologie comme solution universelle peut négliger d’autres facteurs clés (formation des enseignants, contexte socio-culturel, etc.).
Le grand patronat s’offre de cette façon la possibilité d’ouvrir un fructueux marché technologique dont il sera le bénéficiaire, tout en continuant d’influer idéologiquement sur l’école2, sous couvert d’innovation pédagogique. Cette façade affichée d’une « pédagogie alternative » est également utilisée par l’extrême droite. Celle-ci mène ainsi un combat pour une école au service de son idéologie conservatrice et raciste. Le projet idéologique de la fondation Espérance Banlieues en est un parfait exemple.
______________________________________________
1 Refonder l’entreprise, rapport du Conseil National du Patronat Français, 1995.
2 À titre d’exemple, Pierre Mathiot, qui s’est vu confier par le ministre Blanquer la réforme du baccalauréat et du lycée en 2017, est vice-président d’APE depuis 2023.